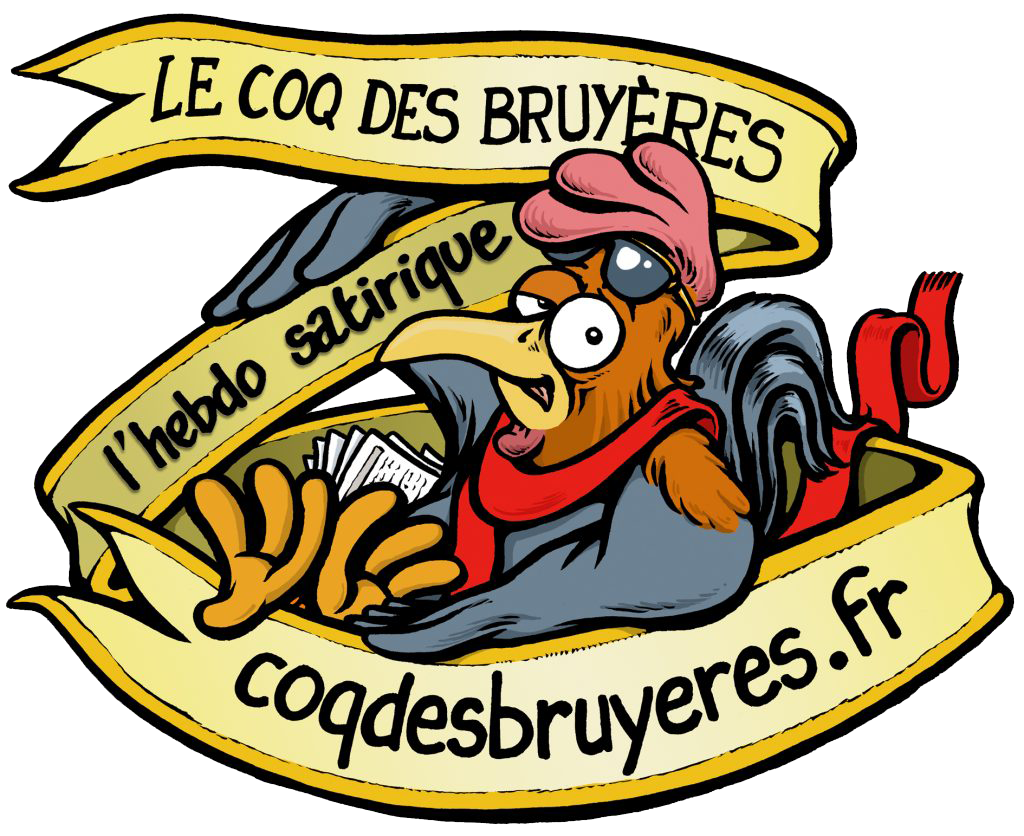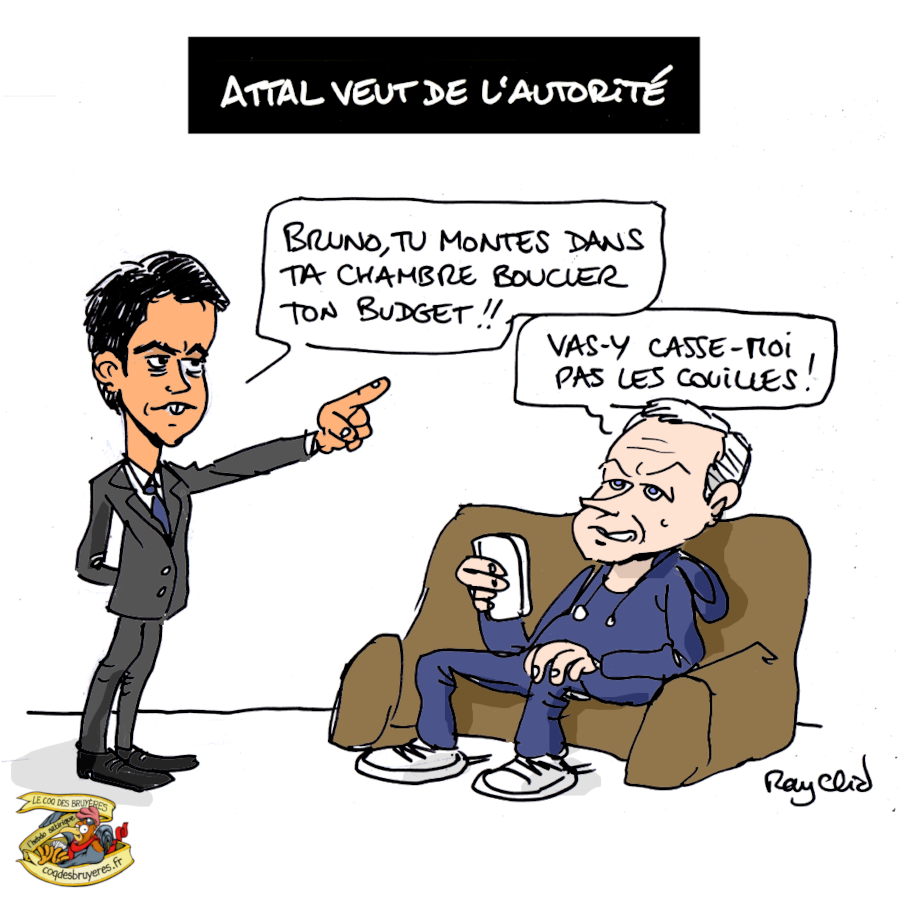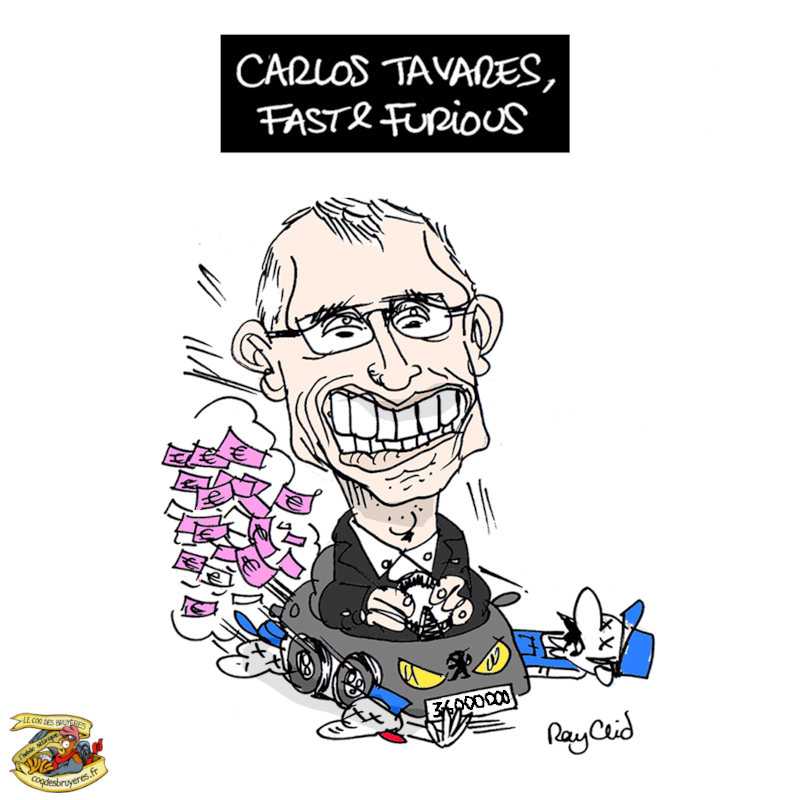Entretien avec Jean-Pierre de Lipowski
Anthony Casanova: Jean-Pierre de Lipowski, vous publiez, aux Éditions Faisons Simple, « Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre », les aventures d’un homme de spectacle qui, ayant ses entrées partout, essaye de donner vie à son idée de polar : faire « le casse du siècle »… Quelle fut la genèse de ce roman ?
 Jean-Pierre de Lipowski: Exactement la même qu’au premier chapitre du roman lui-même où le héros se réveille en ayant rêvé le casse du siècle. Tout s’y passe idéalement, comme dans les rêves s’ils ne tournent pas au cauchemar. Mais au réveil, on le sait, s’effacent les brumeux onirismes du sommeil et on retombe dans la vraie vie où l’on s’aperçoit que le rêve était certes bien beau mais qu’il ne peut s’appliquer au réel. Donc, tout comme le héros de cette aventure, le fameux Stanislas de Zorowski, dit « Zoro », j’ai vraiment rêvé le casse parfait de la Banque de France. Au réveil, le rêve étant encore bien présent, je me suis précipité sur crayon et papier pour le noter et, ce faisant, je me suis aperçu que le « scénario » dudit rêve, bien que tordu, fonctionnait, pouvait s’appliquer au réel, car il reposait sur une fichue bonne idée. Donc j’ai entrepris le roman, contrairement au Zoro de l’aventure qui, au lieu d’en faire, prudemment, un scénario comme le réalisateur de fiction qu’il est, décide carrément de faire le casse. Complètement inconséquent le gars, car, évidemment, rien ne va ensuite se dérouler comme dans l’extase de son rêve.
Jean-Pierre de Lipowski: Exactement la même qu’au premier chapitre du roman lui-même où le héros se réveille en ayant rêvé le casse du siècle. Tout s’y passe idéalement, comme dans les rêves s’ils ne tournent pas au cauchemar. Mais au réveil, on le sait, s’effacent les brumeux onirismes du sommeil et on retombe dans la vraie vie où l’on s’aperçoit que le rêve était certes bien beau mais qu’il ne peut s’appliquer au réel. Donc, tout comme le héros de cette aventure, le fameux Stanislas de Zorowski, dit « Zoro », j’ai vraiment rêvé le casse parfait de la Banque de France. Au réveil, le rêve étant encore bien présent, je me suis précipité sur crayon et papier pour le noter et, ce faisant, je me suis aperçu que le « scénario » dudit rêve, bien que tordu, fonctionnait, pouvait s’appliquer au réel, car il reposait sur une fichue bonne idée. Donc j’ai entrepris le roman, contrairement au Zoro de l’aventure qui, au lieu d’en faire, prudemment, un scénario comme le réalisateur de fiction qu’il est, décide carrément de faire le casse. Complètement inconséquent le gars, car, évidemment, rien ne va ensuite se dérouler comme dans l’extase de son rêve.
Le « héros », Stanislas de Zorowski, est roublard et un brin gros dégueulasse avec sa nièce. Il manipule aussi joyeusement son entourage et a un CV qui fait penser à un certain de Lipowski…
Ah oui, Zoro, le héros, me ressemble étrangement, en tout cas, et j’aime à le penser, dans ses côtés les plus sympathiques. Zoro a mon humour, ma forme d’humour, tirant souvent vers le noir. Son CV — il émarge dans le milieu de la production télévision, dans l’univers médiatique — colle au mien. Et c’est toujours la même chose, on a de l’imaginaire mais on pioche aussi allégrement dans la vie réelle, qui parfois dépasse la fiction, comme le titrait Alain Resnais pour son film « La Vie est un roman ». Donc pas besoin de chercher bien loin pour profiler des personnages, autant emprunter à sa propre personnalité, d’autant que, accessoirement, cela fait aussi psychanalyse et que c’est alors beaucoup moins cher qu’un psy derrière le divan. En revanche, mon personnage de Zoro est beaucoup plus culotté que moi, à preuve, il fait le casse alors que je me suis contenté d’écrire le roman.
Gros dégueulasse avec la nièce ? Oui et non. Oui il la manipule, oui il est jésuite, mais c’est là l’occasion de me moquer de mon héros — donc de moi-même — car ce type est loin d’être parfait, il est, comme tout le monde, ni blanc ni noir, mais gris. Il faut qu’il y ait des ombres, du négatif, comme le disait mon camarade Pierre Desproges auprès de qui l’on s’étonnait qu’il soit toujours détracteur : « Mais si je dis du bien de tout et de tout le monde, je ne suis pas drôle. »
J’aime beaucoup ce personnage de la nièce, geek, moderne, dupe de rien, et par ailleurs, mais ça c’est mes fantasmes, super belle fille. D’ailleurs, la relation entre le héros et la nièce n’est pas très morale, c’est le moins que l’on puisse dire, donc c’est aussi l’occasion de bousculer ladite morale, chose que je ne rate jamais, quand je peux.
Auriez-vous, comme lui, des envies de braquage ?
Des envies de braquage ? Au réel, non, c’est du pur fantasme donc de la littérature. C’est même pas la peur du gendarme ; sous des dehors qui peuvent sembler boutefeux, je suis au fond un petit-bourgeois, respectueux de l’ordre civil. Dans la mesure où il n’est pas corrompu pas un état totalitaire… Si un jour ça bascule et que disparaît l’esprit de la démocratie, si par exemple nos extrêmes, de gauche ou de droite, venaient au pouvoir, je risquerai sans doute d’être moins respectueux de l’ordre, « nouveau », alors établi. Je suis, en l’occurrence, comme Montaigne, je crois aux réformes mais pas à ces révolutions qui débouchent systématiquement sur du pire qu’avant.
Il y a un joli clin d’œil à l’écrivain Maurice Frot, bien connu des amateurs de Léo Ferré…
Mais Maurice est un vrai personnage de roman…! Il est vrai qu’on le reconnaît dans les habits de Maximilien Fort. J’ai travaillé des années avec Maurice, notamment sur le Printemps de Bourges dont il était directeur artistique ; chose étonnante, là encore la fiction emprunte au réel, si mon personnage de Zoro s’associe avec la grande pègre pour réaliser son casse de la Banque de France, le lien se fait grâce à Maurice Frot. Il a notamment écrit un étonnant bouquin, « Le Dernier Mandrin » (Grasset), où il raconte la vie d’un truand célèbre, Jean-Baptiste Buisson, frère de l’ennemi public des années 50, Émile Buisson, celui-là même dont les aventures finiront en roman et en film avec « Flic Story ». Le chapitre où mon héros passe toute une nuit avec le parrain du milieu parisien n’est aucunement inventé, de la première à la dernière ligne, j’ai vraiment vécu ça, à cause ou grâce à Maurice ; ce fut, il est vrai, une expérience humaine un peu space, comme on dit aujourd’hui. Évidemment, les noms ont été changés pour le roman. Courageux mais pas téméraire.
Qu’est-ce qui motive Zorowski ? L’aventure, le défi ou plus simplement l’appât du gain ?
Le postulat du récit était de mettre un Français tout ce qu’il y a de moyen, comme moi en somme, dans une situation où il fonce, persévère, mais pour laquelle il n’est absolument pas armé. Il passe de la réalisation télé au grand banditisme, sérieux grand écart. Vénalité ? oui, bien sûr, comme le suggère le titre du roman, « Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre », mais surtout défi : va-t-il être capable de gérer sa peur, ses angoisses, son inexpérience, dans cette situation foldingue qu’il a déclenchée ? Le héros, en fait, n’arrête pas de s’observer lui-même, de se juger, entre culot absolu et lâchetés minables, et c’est ce jeu du paradoxe qui ouvre à l’humour car ce polar est en fait une comédie policière où l’on rigole souvent. Tout en laissant parfois place à l’émotion, car là encore, jeu de contraste, on ne rit jamais autant que quand on vient de s’émouvoir.
Ce n’est pas un portrait très glorieux que vous dressez du monde du spectacle et de ses satellites médiatiques, on est un peu entre le panier de crabes et le sot d’ordures, non ?
Mais je pourrais faire un roman, ou un scénario, uniquement sur cet univers du spectacle, de la télé, voire du cinéma ! On y manie deux choses fondamentales : l’ego et l’argent. Une fois qu’on a dit ça, on a quasiment tout dit. Une partie conséquente des gens qui gère ces univers, notamment la télévision, sont fort intelligents mais en même temps d’une suffisance crasse, et souvent inculte. Et je parle pas d’Internet, qui est en devenir et qui, de toute manière, va rayer de la carte la télévision d’aujourd’hui, et ce dans les vingt ans qui viennent, voire même avant, le processus est en marche. Relativisons toutefois : dans ces univers, tout n’est pas noir ou blanc mais gris, car j’ai connu, et je connais encore, des gens fantastiques, sensibles, cultivés, qui tout en défendant leur bout de gras, s’attellent à faire leur job de façon honnête. Mais il est vrai que c’est quand même une jungle qui s’explique, faute de se justifier, par ces enjeux : ego et argent.
Certaines trouvailles ou sens de la formule littéraire m’ont fait penser à René Fallet, quels sont les auteurs qui vous accompagnent lorsque vous écrivez ?
Fallet, oui, j’ai lu, il y a bien longtemps, amené à ses romans par le fait qu’il était compagnon de route d’un de mes maîtres : Brassens. Quant aux auteurs qui m’accompagnent à l’écriture… Difficile question. Il y a tout un panthéon de plumes qui s’entreposent quelque part dans mon ciboulot. Je n’ai jamais trop lu de polars ; des Simenon, des Christie, oui, Maurice Leblanc bien sûr avec son Lupin qui, d’une certaine façon, sous-tend mon roman « Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre », mais, spontanément, je ne vais pas, ou plus, sur ce genre de littérature. J’oublie Frédéric Dard, bien que je n’ai lu en tout en pour tout qu’un seul « San Antonio », mais il a une science de l’argot auquel j’ai moi-même souvent recours, car une langue n’est jamais morte, elle bouge avec son époque. En fait, je lis peu quand je suis en phase d’écriture car trop axé sur mes propres lignes. D’ailleurs, j’ai constaté un phénomène particulier : quand je ne parviens plus à me concentrer sur un bouquin, quel qu’il soit, c’est que je suis « enceint », d’un roman, d’un scénario, et qu’il va donc falloir que je me mette d’urgence au boulot pour accoucher d’un nouveau bébé. Sinon, et pour l’heure, je sors d’un Leonardo Padura, auteur cubain — je recommande à tout le monde son « Hérétiques » —, je poursuis, j’allais dire comme tout le monde car il est à la mode, Yuval Noah Harari avec son « Sapiens » et toute la série qui suit, et je plonge régulièrement dans la « Recherche » ; j’en suis à « Sodome et Gomorrhe » car je n’aurais pas la prétention de dire — comme certains qui en font des caisses sur le sujet — que j’ai lu trois fois l’intégrale de Proust ; sur le Marcel en question, qui est sublime mais, avouons-le, un peu dense, je reconnais être un lecteur lent. Mais quelle prouesse de mémoire, et de fiction, chez ce fichu Proust qui, pour un « écriveur » comme moi, offre un trésor inépuisable de vocabulaire.
 Vous avez publié l’année dernière « Louvre story » qui est un voyage dans l’art à travers les yeux d’une jeune américaine. Pensez-vous, à l’instar d’Henri Jeanson, qu’il faut « Un peu de vie dans son art et un peu d’art dans sa vie » en disant que l’histoire d’une œuvre est aussi importante que l’œuvre elle-même ?
Vous avez publié l’année dernière « Louvre story » qui est un voyage dans l’art à travers les yeux d’une jeune américaine. Pensez-vous, à l’instar d’Henri Jeanson, qu’il faut « Un peu de vie dans son art et un peu d’art dans sa vie » en disant que l’histoire d’une œuvre est aussi importante que l’œuvre elle-même ?
Pose pas des questions faciles, le Coq… Jeanson met cette belle sentence dans la bouche de Jouvet, acteur qui n’est pas de ma génération, ou alors j’étais bien jeunot, mais dont je ne me lasse pas. Y a deux réponses possibles : la première, c’est que « Louvre Story » se plaît à dénoncer l’attrait de mes contemporains pour le « mythe », on se pâme devant une œuvre car elle est validée par le consensus ambiant et donc c’est forcément un chef-d’œuvre. Bah oui et non, une œuvre doit parler à ton cœur, à ton âme, et s’il se trouve qu’elle emporte l’engouement de tout le monde, tant mieux, mais ce n’est pas le présupposé obligatoire. J’ai été voir récemment l’expo Basquiat, par exemple, très à la mode ce rebelle, et donc rencontrant l’engouement d’un paquet de… snobs ? J’avoue que, hors le parcours, difficile dans sa jeunesse, de Jean-Michel Basquiat pour lequel on peut avoir de la compassion, sa peinture m’emmerde profondément, pire me consterne. Cabu recevait une fois par semaine des dessinateurs en herbe et, du fond de sa gentillesse extrême, leur donnait des conseils, les encourageait puis, plus tard, si aboutissement, leur faisait la joie de passer un dessin dans Charlie Hebdo. En visitant l’expo Basquiat, je me suis demandé ce qu’aurait pu dire Cabu ouvrant le carton à dessins du new-yorkais. Le connaissant, il y aurait trouvé assurément des qualités, l’aurait conforté. Moi, j’avoue que je n’ai ni l’œil ni la civilité d’un Cabu, et qu’il n’eut pas fallu que je réceptionne un Basquiat à Charlie Hebdo. Mais ça, c’est mon côté réac, encore une fois, ni noir ni blanc, gris.
Basquiat, pour autant, suit le précepte d’Henri Jeanson, il a mis de la vie dans son art, et de l’art dans sa vie. Un peu trop même, il en est mort. Mais cette sentence repose sur une évidence qui vous saute au pif si vous n’êtes pas enchâssé, à vie, dans une bourgeoisie obtuse. Mettre de la vie dans son art, j’y réponds en recyclant dans les romans mes propres expériences, ou en y mêlant à plaisir des événements réels ou des personnalités vivantes, tel le sort que je réserve au malheureux Johnny Depp dans « Histoire à vous couper… » (c’est emmerdant les titres longs quand on est contraint de les répéter régulièrement). Quant à l’inverse, « l’art dans la vie », me viennent deux réponses : d’abord, il faut être fou, ou sacrément notaire — le parangon, à tort ou à raison, d’une existence rangée, bourgeoise —, pour ne pas ménager une place dans notre quotidien à la folie, à l’impromptu, à l’improvisation ou au non-sens ; reste à mesurer la dimension de ladite place qu’on leur réserve. Ensuite me vient en mémoire une production télévision bien particulière, que peu de gens ont vue (Arte programmait cela à minuit) mais qui, étonnamment, est mythique pour ceux qui ne l’ont pas ratée : « One Shot Not ». Il s’agissait d’une émission musicale que j’ai produite durant quatre saisons où le meneur de jeu, Manu Katché, recevait des invités musiciens, figures d’une nouvelle génération. Une bonne partie du programme était dédiée à la musique, live, tout le reste se déroulait backstage : préparation, répétitions, tchatche dans les loges… Et bien j’ai beau aimer la musique par laquelle j’ai été construit en partie, j’ai toujours trouvé plus intéressant, attachant, les parties off. Car c’est en backstage où, loin de la mythologie telle qu’évoquée plus haut et donc du « spectacle » que l’on donne à voir, et qui est, paillettes ou pas, une vitrine, enluminée, c’est loin de ça que se révèle la véritable nature des artistes. Donc oui, je vais préférer, pour ma part et assurément, une enquête artistico-documentaire sur Léonard de Vinci qu’à rester une heure face à la Joconde, ce qui tient d’ailleurs du record vu la tripotée de touristes asiatiques qui s’écrasent devant.
Votre regard sur l’édition et la difficulté de sortir un livre à l’heure actuelle ?
M’étant replongé depuis peu dans le roman, je n’ai qu’un avis relatif sur le milieu actuel de l’édition, si ce n’est qu’une évidence me fait admettre que les éditeurs seraient bien en peine de prendre en compte tous les bouquins qui sont écrits. L’expérience que je tente aujourd’hui avec mon propre label d’édition, « Faisons Simple », est née avec mon précédent roman « Louvre Story ». Envoyé à une pléiade d’éditeurs, dont tu es en droit d’espérer une réponse, quand il y a en a, au bout d’un laps de temps variant entre trois et six mois, trois au final ont retenu l’ouvrage. Fort d’une relation précédente avec une maison d’édition, les Presses de la Renaissance, je me suis alors vu remettre en cause les contrats qui m’étaient proposés. Je ne rentrerai pas ici dans le détail car ça serait trop long, mais, fort des réserves que soudain j’émettais, j’ai commencé à réfléchir au fait que je pouvais être mon propre éditeur. J’étais aidé en cela par la récente expérience de Perrine Desproges (« la fille de… » comme elle dit en ironisant sur elle-même) qui venait de sortir en auto-édition, et avec succès, son « Desproges par Desproges ». Le numérique a porté sa révolution partout, y compris jusqu’au littéraire, et il est désormais facile, et accessible financièrement, d’être son propre éditeur car distribué via Internet. Avec la distribution par le web, on aborde là une sacrée polémique : les libraires font la gueule car ils perdent, de fait, en chiffre d’affaire — certains auteurs connus et référencés commencent en effet à s’auto-éditer ainsi — et idem pour les éditeurs dont certains, quand même, ont un double langage. Ils réagissent comme les maisons de disque, un peu en difficultés aujourd’hui avec l’essor du numérique, qui louchent sur les millions de clics d’un clip fabriqué, homemade, par des inconnus et propulsé par You Tube. Pourquoi ? C’est simple : You Tube fait le boulot pour eux, celui auquel ils s’astreignaient à l’époque de leur gloire et qui les voyait investir sur de nouveaux talents. Désormais, plus besoin d’aller creuser pour trouver une future star, il suffit de surveiller l’ascension des clics et, le jour où l’on estime que c’est mûr, on s’applique à signer cette nouvelle vedette issue du virtuel. Idem avec les maisons d’éditions qui ne sont pas les dernières à reluquer les scores servis par Amazon, qui défraie la chronique, certes, mais qui caracole largement en tête des ventes diverses et variées, y compris en matière de littérature. C’est, une fois de plus, spécifique à cette société qui a horreur du vide : les éditeurs ne peuvent avaler tout ce qui s’écrit, mais la révolution numérique y remédie tout en mettant en lumière — avec plus ou moins de bonheur, ne faisons pas non plus un tableau trop idyllique — des talents qui, sans elle, seraient passés à la trappe. En ce qui me concerne, tant pour mon dernier roman que pour les futurs, j’ai réglé un problème majeur de l’auteur : la parution. Certes, je peux trouver moins de lecteurs que soutenu par un éditeur ayant pignon sur rue mais, en revanche, l’inquiétude qui t’assaille à écrire un roman « dans le vide », soit faire suer le burnous de ton imaginaire pour un texte qui finira dans la poubelle, est désormais sortie de mes préoccupations.
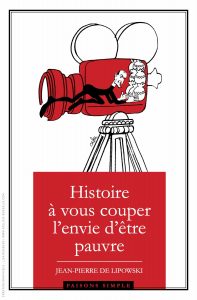 Vos futurs projets, vos prochaines envies ?
Vos futurs projets, vos prochaines envies ?
Je travaille à cette heure sur un nouveau roman : « Pure et simple ». Comme pour « Louvre Story », il s’agit d’une « novélisation », cet anglicisme voulant simplement dire adaptation d’un scénario de long métrage en roman. « Pure et simple », comme « Louvre Story », sont au départ écrits par le scénariste que je suis également, mais comme on rame, encore plus qu’en roman, pour la production d’un film, il me semblait tristos que ces deux histoires ne puissent se matérialiser, ni du coup rencontrer un public, d’où leur adaptation en roman.
Le projet suivant sera exactement l’inverse : « Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre », avec ses suspens, rebondissements, sa tonalité baroque des personnages, ferait un excellent scénario de comédie policière. Reste pour moi à analyser mes propres écrits afin de couper dans le roman pour n’en retenir que les séquences les plus cinématographiques ; ça, ce n’est pas le plus facile, écrire ensuite le scénar sera un plaisir, ineffable, que je me réserve.
Donc, à suivre, et merci au Coq de me laisser quelques plumes pour tout ce qui me reste à écrire.
Propos recueillis par Anthony Casanova
pour commander Histoire à vous couper l’envie d’être pauvre, cliquez ici !
pour commander Louvre Story, c’est ici !

Par Jean-Pierre de Lipowski
Insoumis, affranchis-toi
Cher Insoumis, dernièrement tu as entendu, la tête de liste pour La France Insoumise aux élections européennes, Manon Aubry, déclarer : « on ne peut pas faire l’union à gauche sans Mélenchon » en...
L’attrait du vide
Comment comprendre les violences grandissantes? Comment ne pas subir sans rien faire? Comment effacer les images sanguinolentes sans rien dire? Comment ne pas confondre les victimes et les...
Le mépris
Avez-vous entendu parler de « Coquelicots TV » ? Voici le désopilant surnom choisi par le candidat Bardella aux européennes pour désigner la chaîne Public Sénat. Le jeune président du...